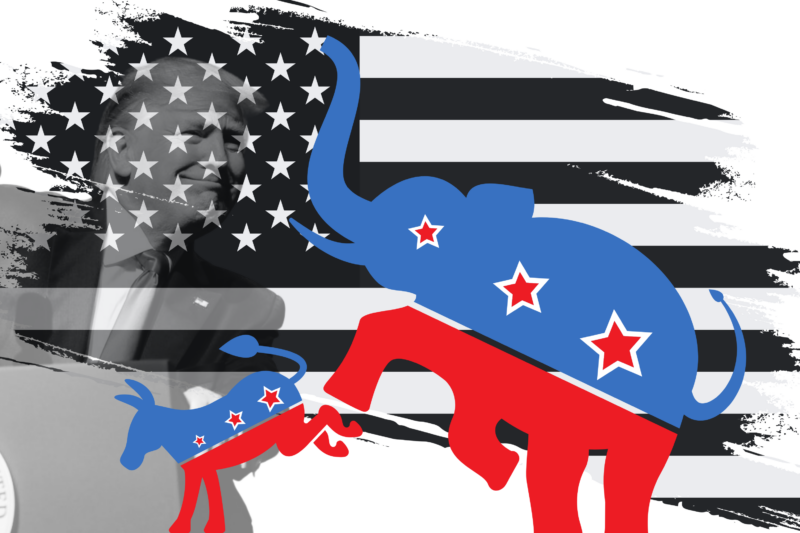Direction le pays des Incas, le Pérou, cette terre fascinante imprégnée de traditions ancestrales et de cultures millénaires. Pourtant, ce pays magnifique est depuis bien longtemps marqué par des crises politiques incessantes. Le Laboratoire de la République profite de la présence d’un de ses chargés de mission, Erévan Rebeyrotte, pour offrir un témoignage de la mémoire historique et politique du Pérou.
Cette lettre s’est enrichie grâce à deux rencontres : celle de Fernando Carvallo, ancien représentant du Pérou à l’Unesco et ancien directeur du musée de la mémoire à Lima (en faveur des victimes de conflits armés) et celle de Luis Jaime Castillo, ancien ministre de la culture. Mais elle a aussi été nourrie par les témoignages des Péruviens rencontrés au cours de l’exploration de ce pays fascinant, à la fois bouleversant et grandiose.
Lorsque Pía, une amie péruvienne, résuma l’histoire de son pays par ces mots « una historia de dolor, olvido y lágrimas » (une histoire de douleur, d’oubli et de larmes), elle capturait toute la tragédie qui traverse le Pérou depuis des décennies. Comme tous les Péruviens que j’ai croisés, Pía désigne les hommes et les femmes politiques, accusés de corruption et d’illégalité, comme responsables de cette spirale de souffrance collective. Une souffrance exacerbée par la violence du terrorisme, héritage encore vivace dans la mémoire du pays. Un exemple récent : lorsque j’arrivai à Lima, mi-mars, la capitale était en état d’urgence après qu’un groupe de tueurs à gages ait ouvert le feu sur un bus transportant l’orchestre péruvien Armonía 10, dont faisait partie le chanteur Paul Flores.
Luis Jaime Castillo, ancien ministre de la culture, me confia sa conviction que l’État péruvien devrait prioriser la lutte contre la pauvreté sociale et économique plutôt que de concentrer ses efforts sur une politique de mémoire pour recenser les traumatismes du peuple. Selon lui, le pays doit se tourner vers l’avenir et améliorer le quotidien de ses citoyens, tout en combattant des phénomènes comme le wokisme et le néo-féminisme, qu’il considère comme des vecteurs de haine. « Les peuples indigènes sont reconnus en Amazonie, mais comme dans tous les pays d’Amérique, à la différence de la France, les communautés ne jouissent pas des mêmes droits. Chaque groupe bénéficie d'avantages spécifiques. Il n'existe aucune véritable politique d'égalité. Le wokisme, en cherchant à effacer l’histoire des conquistadors, a contribué à la montée des mouvements réactionnaires. La victoire de Trump est le fruit d’une campagne démocrate déconnectée des préoccupations réelles du peuple américain, notamment la question de l’immigration. », me confia-t-il avec une conviction conservatrice.
Fernando Carvallo, quant à lui, insiste sur la nécessité pour le Pérou de se ressourcer dans les leçons du passé afin de ne pas répéter les erreurs qui ont conduit à la situation actuelle. Le pays, selon lui, doit tirer les enseignements des échecs du passé pour construire un avenir meilleur. Et les faits sont là : le Pérou est le seul pays au monde où tous les présidents du XXIe siècle sont, ou ont été, impliqués dans des affaires judiciaires graves. Certains sont actuellement devant la justice, d’autres sont emprisonnés. Depuis la naissance de la République péruvienne, le pouvoir est vu comme une ressource financière personnelle, une coutume qui perdure.
Sous le mandat de Dina Boluarte, élue vice-présidente en 2021, et maintenant présidente, le Pérou a vu naître un gouvernement plus à droite que tout ce que le pays n’avait connu depuis des décennies. La présidente fait face à plusieurs enquêtes, notamment des accusations concernant des opérations de chirurgie cachées au Congrès, avec des allégations selon lesquelles le chirurgien n’aurait pas fait payer ses opérations avec la garantie de postes administratifs pour ses amis et sa famille. Ce climat de méfiance et de corruption se perpétue.
Dans les profondeurs de la vallée sacrée, entre Pisac et le Machu Picchu, la réalité péruvienne prend un tour encore plus désolant. Les communautés locales, laissées pour compte, sont totalement exclues du système médical et judiciaire. La police est absente, et le plus proche hôpital se trouve à des heures de marche, ou de cheval, traversant des cols escarpés. Les seules traces de vie politique visible sont les slogans peints sur les murs des maisons, évoquant les prochaines élections présidentielles de 2026 avec une cinquantaine de candidats !
Mais aujourd’hui, il semblerait que le Pérou, malgré ses souffrances internes, ait trouvé un allié en dehors du continent : la Chine. Ce pays investit massivement dans les infrastructures péruviennes, notamment à travers des projets portuaires qui suscitent la méfiance des États-Unis. Le Pérou est désormais vu par les Américains comme une « colonie chinoise » en devenir, un projet géopolitique qui pourrait redéfinir l’équilibre de puissance dans cette région.
Ainsi se dessine, à travers ces rencontres et témoignages, l’histoire du Pérou : un pays où les cicatrices du passé sont encore bien visibles, mais où le regard se tourne inexorablement vers l’avenir, malgré les défis immenses. Entre douleur et espoir, oubli et résistance, la route reste longue pour cette nation qui cherche à se reconstruire, tout en affrontant les démons de son histoire et les failles de son présent. Un pays magnifique, certes, mais un pays qui porte en son âme les traces indélébiles de luttes sans fin.