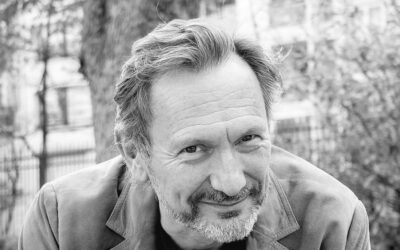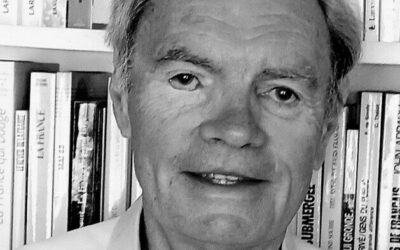À l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire, le Laboratoire de la République interroge Nathan Smadja, le président-fondateur de l’association Résiste. Lui qui a survécu au harcèlement scolaire pendant son adolescence, il incarne la résistance face à ce fléau qui hante les couloirs des écoles et les vies de trop nombreux enfants à travers la France. Il a été nommé ambassadeur de la lutte contre le harcèlement scolaire par le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, en septembre dernier.
Le Laboratoire de la République : Votre association Résiste est engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans ce cadre, quelles actions et quels outils déployez vous pour lutter efficacement contre cela, pour favoriser la libération de la parole et les signalements, et pour aider les victimes à surmonter leur harcèlement ?
Nathan Smadja : "Notre association, Résiste, s'engage fermement dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous mettons en place une série d'actions visant à sensibiliser et prévenir le harcèlement à l'échelle nationale, en ciblant les élèves, le personnel éducatif et les parents.
En collaboration avec les établissements scolaires et les académies, nous agissons en complément des dispositifs existants du Ministère de l'Éducation nationale, tels que le programme « PhAre », généralisé depuis la rentrée scolaire de 2023. Ce programme, initié sous l'égide de Jean-Michel Blanquer et élaboré sur les bases des travaux de spécialistes comme Jean-Pierre Bellon, rétablit la priorité du bien-être à l'école. Grâce à des élèves ambassadeurs, la lutte contre le harcèlement est devenue une mission collective impliquant tous les acteurs de l'éducation nationale, des élèves aux enseignants.
Ensuite, notre association apporte un soutien aux victimes de harcèlement, tant sur le plan juridique que psychologique. Nous constatons un manque crucial de communication concernant les ressources mises à disposition, aussi bien pour les victimes que pour les personnes auteurs de harcèlement.
J'ai eu l'opportunité de présenter un ensemble de propositions à Gabriel Attal au début du mois de septembre. Par la suite, lors de l’annonce du plan contre le harcèlement à l’école à et en collaboration avec d'autres acteurs impliqués dans la lutte contre le harcèlement, j’ai attiré l'attention de la Première ministre, Elisabeth Borne, sur la nécessité d'accompagner les enfants harceleurs. Naturellement, la fermeté des sanctions est cruciale. Par exemple, l'exclusion de l'élève harceleur est une mesure adaptée et proportionnée. Cette mesure était attendue et essentielle. Cependant, il est essentiel de ne pas abandonner ces enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer des millions d'élèves. En effet, le nombre de victimes de harcèlement à l'école est estimé à environ 1 million, mais les personnes impliquées dans des actes de harcèlement agissent souvent en groupe, multipliant ainsi le nombre de personnes qualifiables de harceleurs.
Ainsi, l’association Résiste a pour but de réaliser des actions de sensibilisation, de soutien aux victimes et d'accompagnement des harcelés comme des harceleurs, tout en essayant d’être un lien entre l’institution, les collectivités et les acteurs clés dans la lutte contre le harcèlement scolaire.”
Le Laboratoire de la République : Le harcèlement scolaire peut prendre de nombreuses formes, parfois difficiles à définir juridiquement. Comment peut-on mieux accompagner les victimes et les éducateurs pour reconnaître et traiter le harcèlement sous toutes ses formes, y compris celles qui ne sont pas faciles à caractériser sur le plan juridique ?
Nathan Smadja : La reconnaissance et la gestion du harcèlement scolaire sous toutes ses formes présentent un défi important, en particulier lorsqu'il s'agit de caractériser légalement certaines situations. Jusqu'à récemment, un silence pesant et la mentalité du "pas de vagues" ont malheureusement entravé la prise de conscience et les actions concrètes au sein des institutions éducatives. J'espère que cette époque est derrière nous. Cependant, il a fallu plusieurs drames, impliquant des enfants âgés de 10 à 15 ans, pour que la société prenne réellement la mesure de l'ampleur de ce problème.
L'enjeu crucial réside désormais dans la détection précoce du harcèlement, avant qu'il ne prenne des proportions plus graves. La complexité provient de la diversité des formes que peut prendre le harcèlement, en particulier avec l'émergence et l'omniprésence des réseaux sociaux, rendant parfois difficile l'identification des cas de harcèlement.
D'un point de vue légal, le harcèlement scolaire constitue un délit depuis la loi du 2 mars 2022. Cette reconnaissance comme délit apporte une réponse pénale claire et précise. Néanmoins, cela peut s'avérer complexe, notamment lorsqu'il s'agit de recueillir des preuves dans le cadre du harcèlement en ligne via les réseaux sociaux. Pour cela, faire appel à un commissaire de justice pour authentifier ces preuves peut être une voie à explorer. De manière plus large, la justice doit elle aussi être au rendez vous.
Enfin, les associations et fondations jouent un rôle crucial en accompagnant les victimes, en les aidant à naviguer dans les démarches et en établissant le lien avec les familles. Elles agissent comme des facilitateurs dans un processus qui ne peut être affronté par les familles seules."
Le Laboratoire de la République : Face au nombre de victimes présumées, les magistrats craignent qu’une judiciarisation systématique du harcèlement entraîne une submersion de dossiers. Quelles alternatives à la judiciarisation du harcèlement permettraient de mettre un terme aux agissements et de prévenir au mieux leur récurrence ?
Nathan Smadja : Au-delà de l'aspect judiciaire, notre priorité principale reste la détection précoce du harcèlement. La complexité réside dans les moyens d'identification de ces situations, avant même d'envisager des actions en justice, que ce soit au sein de l'école ou sur les réseaux sociaux.
Il est crucial de souligner qu'il n'existe pas de profil "type" pour les victimes ou les harceleurs. La diversité des personnes impliquées dans ces situations rend la détection et la prévention plus complexes, nécessitant une approche nuancée.
La pédagogie et la transparence apparaissent comme des outils fondamentaux dans la lutte contre le harcèlement. Une sensibilisation accrue de tous les acteurs impliqués, notamment les éducateurs, les élèves et les familles, est primordiale. Cette sensibilisation pourrait être intégrée dans les programmes éducatifs, afin d'enseigner non seulement sur les conséquences du harcèlement mais aussi sur les moyens de le détecter et d'y réagir adéquatement.
Afin de lutter contre le harcèlement de manière proactive, il nous faut avoir une approche multidimensionnelle, axée sur la prévention, la sensibilisation, le soutien psychologique, et la mise en place de mécanismes de signalement, peut offrir des alternatives à la judiciarisation tout en visant à éradiquer le harcèlement et à prévenir sa récurrence."
Le Laboratoire de la République : Quels sont les défis les plus importants que vous rencontrez dans vos activités associatives ? Face à cela, quelles nouvelles mesures, initiatives ou approches vous donnent espoir dans la capacité de notre République à répondre au défi posé par le harcèlement scolaire ?
Nathan Smadja : Mon engagement dans la lutte contre le harcèlement scolaire est avant tout motivé par la volonté de garantir à chaque élève en France un environnement éducatif propice à l'apprentissage. L'école de la République devrait être un sanctuaire pour l’apprentissage des élèves. Personne ne devrait être contraint de quitter le système éducatif en raison de moqueries ou d'agressions. Il est déchirant de voir des vies d'enfants brisées à cause du harcèlement, et il est inacceptable qu'un élève redoute chaque jour d'aller à l'école.