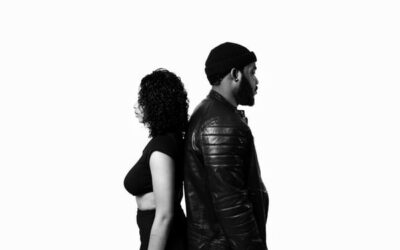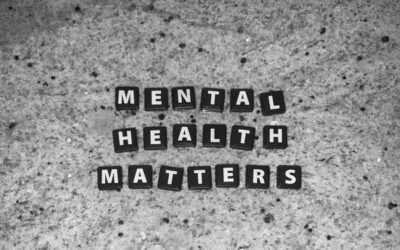Le conseil scientifique de la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT) a été dissous ce vendredi 20 janvier. Cette dissolution intervient après la multiplication d’interventions radicales et de tentatives d’intimidation de la part d’organisations souhaitant imposer leur agenda sur l’institution. Afin de donner un éclairage contradictoire aux évènements, Le Laboratoire de la République laisse ici la parole à Sophie Élizéon, déléguée interministérielle.
Le Laboratoire de la République se saisit de la dissolution, le vendredi 20 janvier, du conseil scientifique de la DILCRAH, relayée par le Point sur son site, un évènement qui suscite au sein du Laboratoire une grande inquiétude sur les capacités de résistances de nos institutions face aux démarches de certaines organisations. Soucieux d’éclairer les évènements en donnant la parole à toutes les parties, nous avons interrogé Sophie Élizéon qui nous donne ici sa version des faits.
Pour retrouver les réponses de Denis Peschanski, rendez-vous ici.
Le Laboratoire de la République : Pouvez vous nous donner votre interprétation de la genèse de cette décision ?
Sophie Élizéon : Il ne s’agit pas d’une interprétation mais des éléments factuels qui ont conduit à cette décision prise en accord avec les tutelles de la DILCRAH.
En février 2016, conformément à la mesure 23 du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, un conseil scientifique est installé auprès de la DILCRA, qui devient DILCRAH en juillet 2016. Au premier semestre 2017, de nouveaux membres sont intégrés au conseil scientifique pour prendre en compte l’extension du périmètre d’action de la DILCRAH.
Aucun texte n’encadre le fonctionnement ou les missions de ce conseil scientifique.
En novembre 2021, le président du conseil scientifique, Smaïn Laacher, et moi-même proposons aux membres, réunis en plénière, de doter le conseil d’outils permettant d’organiser son travail, son mode de saisine/auto saisine et l’implication des membres. En vain : la proposition ne prospère pas.
En 2022, nous avons fêté les 10 ans de la DILCRAH. En dix ans, nos moyens d’intervention ont évolué, nos missions ont été élargies, les plans adoptés par le Gouvernement pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT ont évolué. Dès lors, il semblait opportun de repenser les modalités de mobilisation du monde scientifique. Qui plus est, l’année où le Gouvernement se dote de deux nouveaux plans d’actions : le plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine sera présenté le 30 janvier et le prochain plan LGBT, dont les travaux d’écriture sont lancés aujourd’hui.
Le sujet de la transidentité n’est donc pas à l’origine de la dissolution du conseil scientifique.
Le Laboratoire de la République : Quel est, selon vous, le rôle d’associations jugées radicales sur le sujet de la transidentité et comment faudrait-il gérer le rapport à celles-ci ?
Sophie Élizéon : Il me semble que cette question en amène deux autres : qui « juge » le caractère radical des associations ? Est-il possible également de questionner les méthodes employées par d’autres types d’organisations pour parvenir à leurs fins ?
Je souhaite répondre à cette dernière question, avant d’aborder celle du rôle des associations, et pour ce faire le rappel d’un certain nombre de faits me parait nécessaire.
En mai 2022, un article parait sur la présence de Smaïn Laacher, président du conseil scientifique de la DILCRAH, dans le conseil scientifique de l’Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent, autrement appelé l'Observatoire de la petite Sirène. Smaïn Laacher, professeur émérite de sociologie à l’université de Strasbourg, ancien juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d’asile, spécialiste des questions migratoires est présenté sur le site dudit observatoire uniquement avec sa qualité de président du conseil scientifique de la DILCRAH. Pourquoi ce choix ?
À la suite de cette parution, nous (c’est-à-dire le président Laacher, le DILCRAH adjoint et moi-même) avons reçu, à leurs demandes respectives, d’une part des associations de défense des droits des personnes Trans et alliées, d’autre part les co-fondatrices de l’Observatoire de la petite Sirène. Au cours de ces deux réunions, leur attention a été attirée sur les méthodes employées tant par certaines associations que par l’observatoire, à savoir le recours à l’invective par médias interposés, la déformation des communications de la délégation, qui ne semblaient pas propres à instaurer un climat de confiance et d’échanges professionnels.
En septembre 2022, les membres du conseil scientifique de la DILCRAH, reçoivent un message de l’observatoire directement sur leurs adresses courriels, que ni le président Laacher, ni mon adjoint ni moi ne lui avons communiquées. Comment l’observatoire s’est-il procuré ces contacts qui ne sont pas publics ?
En décembre 2022, des membres du conseil scientifique de la DILCRAH adressent par la voix de leur président un communiqué de presse à une dizaine de médias. 3 heures après cette diffusion, qui n’a encore donné lieu à aucune publication, l’observatoire se sert de ce communiqué et du nom de la DILCRAH (citée 5 fois dans un courriel de plus de 40 lignes) pour invectiver une collectivité qui avait décidé de ne pas prêter de salle pour accueillir un colloque dans le cadre duquel des membres de l’observatoire devaient intervenir. 4 à 5 heures après l’envoi du CP à la dizaine de médias et alors même que ce communiqué n’a toujours pas été repris, il est relayé sur les réseaux sociaux par l’observatoire qui prétend que ce CP émane de la DILCRAH et la remercie pour son soutien. La délégation est contrainte de démentir, puisqu’elle n’est pas à l’origine de ce communiqué de presse.
À la lumière de ces faits, de mon point de vue, il ne fait aucun doute que le conseil scientifique et la DILCRAH ont été instrumentalisés dans cette affaire.
Sur la question des associations. De tout temps, le militantisme associatif a permis à la société de progresser dans de nombreux domaines : l’égalité entre les femmes et les hommes, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la santé ou encore la protection et de la promotion des droits humains, dont fait partie la lutte contre la haine anti-LGBT.
Ce militantisme peut prendre plusieurs formes, de la plus collaborative à la plus vindicative. Dans un État de droit, il est important que ce militantisme puisse s’exprimer… dès lors qu’il ne menace pas l’ordre public.
Sur certains sujets, qui touchent à l’intime, le militantisme est parfois dur et exigeant. Il l’est d’autant plus lorsque les associations sont portées par des personnes directement concernées dans leur chair par les sujets sur lesquels elles sont investies. C’est le cas sur la question de la transidentité et lorsque l’on est capable de faire preuve d’empathie, au sens de voir en l’autre une version possible de soi-même, on comprend aisément cette exigence.
Doit-on interagir avec ces associations ?
Cette interaction fait partie des missions de la DILCRAH : elle nous permet de saisir le pouls d’une partie des publics ciblés par les politiques publiques que nous portons, elle nous permet d’identifier les espaces où l’égalité en droits de toutes et tous n’est pas respectée. Certaines de ses associations sont nos partenaires dans la déclinaison territoriale des plans nationaux, d’autres ont pris part à l’élaboration des plans nationaux, d’autres encore prennent part à l’élaboration d’outils (fiche pratiques, guides etc.) que nous déployons sur les sujets sur lesquels nous sommes missionnés.
Comment interagir avec ces associations ?
D’abord en faisant attention à la forme de nos propos et en respectant les personnes membres de ces associations, en gardant à l’esprit que derrière le militantisme il y a des êtres humains. Choisir des termes ou expressions comme « épidémie d’enfants trans », « subculture idéologique » ou encore « trans-activisme », qui sont des termes et expressions utilisés, notamment, par l’Observatoire de la petite Sirène, n’est pas le meilleur moyen de faire entendre le fond du message que l’on cherche à porter.
Ensuite en étant disposé à la controverse et non à la polémique. Je reprends ici ce que j’ai retenu de prises de parole de Smaïn Laacher qui rappelle que la disposition à la polémique est en réalité une disposition à la guerre, quand la disposition à la controverse est une disposition au véritable débat, qui suppose a minima l’écoute et le respect.
Il est, de mon point de vue, bien plus troublant de trouver les mêmes capacités d’invective, la même dureté, la même manière « radicale » d’intervenir, du côté de personnes qui se disent professionnelles préoccupées par la protection des enfants et qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles sont capables de développer des approches scientifiques, de prendre de la distance avec le sujet qu’elles étudient, de l’observer avec objectivité ou tout au moins de savoir d’où elles observent ce sujet. Et pour ma part j’ai une idée assez claire de ce qui je considère comme radical entre le fait de parler « d’épidémie d’enfants trans » quand on est une ou un spécialiste de l’âme humaine et celui de considérer que ces propos sont porteurs de transphobie, quand on est soi-même une personne trans.
Le Laboratoire de la République : La pertinence d’un conseil scientifique associée à une instance publique chargée de lutter contre les discriminations est-elle remise en cause ?
Sophie Élizéon : La DILCRAH est chargée de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Une telle mission a un effet sur la société dans laquelle nous vivons et les rapports sociaux qui en découlent.
Dans ce cadre, il est important de pouvoir se référer à des travaux de scientifiques dont l’expertise sur ces sujets est avérée. La dissolution du conseil scientifique ne signifie pas que la DILCRAH se coupe du monde et de la réflexion scientifique. Cela veut simplement dire que les modalités de mobilisation des scientifiques à nos côtés sont à réinventer. Il y a parmi les membres du conseil scientifique dissous des personnes qui dans leur activité professionnelle portent des projets que la délégation soutient, nous conservons le dialogue avec ces scientifiques et la possibilité de nous parler, dans l’attente de la définition de ces nouvelles modalités.