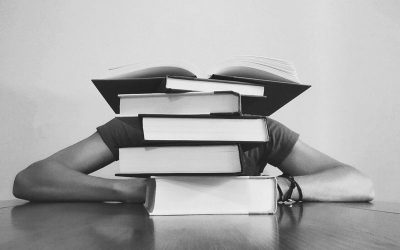Jamais la science n’a été aussi centrale dans l’histoire de la civilisation occidentale, jamais la res publica n’a autant compté sur elle pour concevoir de nouveaux horizons, créer un avenir qui apparaisse comme un progrès, façonner une destinée commune.
Jamais la science n’a été aussi centrale dans l’histoire de la civilisation occidentale, jamais la res publica n’a autant compté sur elle pour concevoir de nouveaux horizons, créer un avenir qui apparaisse comme un progrès, façonner une destinée commune. Et pourtant la tour d’ivoire de la recherche paraît ébranlée et ses fondements épistémiques sont attaqués de l’intérieur comme de l’extérieur.
Or une science qui féconde la société est une science consciente de sa valeur patrimoniale, de ce que les savoirs du passé charrient de l’esprit humain, de sa faculté à édifier ce lieu sublimé d’humanité qu’est la cité.
La science s’inscrit par essence dans un espace-temps sans fin, jalonné de vérités provisoires, sur lesquelles s’édifient selon des continuités ou des ruptures épistémiques les connaissances de demain. La mise en cause de l’éthique du vrai et de la rationalité scientifique entraîne une forme nouvelle de rejet des savoirs constitués, de l’expertise intellectuelle ou technique, de la parole d’autorité, et parfois de la possibilité même d’un dialogue argumenté, du partage des acquis, d’un langage commun. Cette tentation d’une vérité alternative, sujette à la subjectivité et à perméable à l’écume du temps comme aux projections identitaires, laisse entrevoir le risque d’un reniement de la part d’un pan croissant de la société du contrat social, par conséquent du pacte qui relie idéalement la cité scientifique et la polis.
Nombreuses sont donc les raisons qui justifient que la relation entre science et société, entre recherche et enseignement, d’un côté, divulgation et profit social, de l’autre, soit au cœur d’une réflexion qui se veut à la fois analytique et épistémique, tout en proposant des orientations pouvant offrir des perspectives à un débat public et à une loi qui paraissent urgents. C’est ce contrat de moyens et de finalités que les trente propositions cherchent à redéfinir, renforcer, ancrer dans une éthique partagée du vrai, de la connaissance comme vertu, pour nourrir une nouvelle paideia.
La présente réflexion collégiale s’appuie sur les analyses de spécialistes représentant les grands secteurs disciplinaires1.
1 Groupe coordonné par Claudio Galderisi, avec les contributions de Pierre Caye, Philippe Dulbecco, Bénédicte Durand, Gabriele Fioni, Philippe Hoffmann, Alain Laquièze, Didier Moreau, Franck Neveu, Jean-François Sabouret, Pierre Schapira, Carole Talon-Hugon, Jean-Jacques Vincensini, Philippe Walter.
Vous pouvez consulter la totalité des travaux du groupe ci-dessous et en téléchargement :
Scientia ad civitatem - Pour un nouveau pacte social - Janvier 2022Télécharger