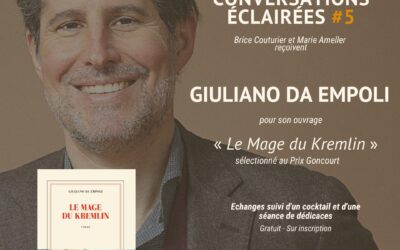Docteur en science politique, Olivia Leboyer enseigne la science politique à Sciences po Paris. Elle est l’auteur de l’ouvrage Élite et Libéralisme, (Éditions du CNRS, 2012, prix de thèse de la Maison d'Auguste Comte). Elle travaille sur la confiance, et a notamment publié "La confiance au sein de l'armée" (Laboratoire de l'IRSEM, n°19), “L'énigme de la confiance" et "Littérature et confiance" (co-écrit avec Jean-Philippe Vincent) dans la revue Commentaire (n°159 et 166). Elle est également critique cinéma pour le webzine Toutelaculture.
Vers la fin de De la Démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville a cette remarque frappante : « Les citoyens qui vivent dans les siècles démocratiques (...) aiment le pouvoir ; mais ils sont enclins à mépriser et à haïr celui qui l’exerce »[1].
Comme si les citoyens aimaient le pouvoir pour sa grandeur, pour ce qu'il a, pour eux, d'inaccessible et haïssaient les élus pour le démenti que leur présence apporte à cette croyance. Le terme élite renvoie à la face cachée de la représentation, à la dimension symbolique du pouvoir. L’élite politique est-elle assimilable à une sorte de précipité, au sens chimique, de toutes les ambiguïtés de la démocratie ? On voit bien, aujourd'hui, que les hommes politiques inspirent une certaine défiance, et que la personne du président de la République Emmanuel Macron concentre même, sporadiquement, une haine disproportionnée. Dans un article de Commentaire, l'économiste Jean-Philippe Vincent rappelait que l'envers de la confiance, plus que la méfiance, est, plus profondément, l'envie[2]. Récemment, la sociologue Dominique Schnapper abondait dans ce sens en voyant dans le rejet de la figure présidentielle par les citoyens un exemple de la haine démocratique identifiée par Tocqueville, fondée sur l'envie[3]. Et plus l'élu possèderait de qualités distinctives, jeunesse, brio, comme Emmanuel Macron par exemple, plus il apparaîtrait distant et susciterait jalousie et ressentiment.
La distinction de l’élite politique s’accompagne nécessairement d’une relation avec la majorité gouvernée. Ce rapport peut être pensé selon des perspectives très différentes, selon l’idée que l’on se fait d’une « bonne représentation ». De fait, on peut estimer primordial de préserver la distance entre les représentés et des représentants choisis pour leur supériorité sur ces derniers. Mais il est également possible de privilégier un idéal de ressemblance. Où l’on considère que les membres de l’élite ne peuvent comprendre les intérêts et besoins des citoyens qu’en étant, pour ainsi dire, « comme eux »[4]. Quels critères conduisent les électeurs à choisir leurs représentants ? Il semble que, de plus en plus, une tendance s’affirme qui les porte à rechercher une plus grande ressemblance entre des hommes politiques et des citoyens ordinaires. Mais est-ce si sûr ? La notion de ressemblance est elle-même très complexe, et toujours partielle. On ne ressemble jamais à une « communauté » que par un ou deux aspects.
Intuitivement, l’on pourrait analyser la notion de ressemblance non pas tant comme le désir de voir les gouvernants « être comme » les gouvernés, que comme la hantise de voir les gouvernants se ressembler tous entre eux, au point de former une sorte de caste. Ainsi, le désir de ressemblance serait l’autre nom pour désigner, sur un mode plus positif, la peur de la domination. De la même manière, la passion de l’égalité se fonde également sur une profonde aversion des inégalités. Il semble que le désir de ressemblance obéisse à des ressorts assez ambigus, puisque l’on souhaite distinguer celui qui nous ressemble et qui, de ce fait, ne nous ressemblera plus autant. Mais, précisément, il s’agit de porter au pouvoir quelqu’un qui, en définitive, pourrait être nous. S’opérerait ainsi une sorte de processus de transposition, le candidat élu renvoyant à ses électeurs une image hautement valorisante d’eux-mêmes et représentant l’un de leurs possibles.
Dans le désir de voir le lien entre l’élu qui leur ressemble et le groupe dont ils se sentent partie, les électeurs conjurent, en quelque sorte, la hantise de l’élite politique dans ce qu’elle a de plus menaçant, soit la constitution d’un corps privilégié, dont les membres se sentent véritablement semblables les uns aux autres. Le « sentiment du semblable »[5] analysé par Tocqueville comme le cœur et l’impulsion du processus démocratique trouverait ici une réalisation restreinte. Il se développerait, non pas entre tous les citoyens indifféremment, mais au sein d’un petit « entre soi », contrariant ainsi le mouvement de la démocratie. En d’autres termes, le désir de ressemblance exprime également, sur un plan plus inconscient, la peur de l’indifférence, de l’oubli, de l’absence de considération. C'est cette appréhension qui s'est fait sentir vivement au moment de la crise des gilets jaunes.
Le désir de ressemblance peut recouvrir une peur de la domination, de l’envie, comme un amour de l’égalité et de la justice, tous ces mouvements n’étant pas exclusifs les uns des autres. Mais, à quelque profondeur que se cachent les raisons, le développement du sentiment du semblable produit un effet quasiment évident : en effet, il exige la réciprocité. Pour restaurer un lien de confiance, les femmes et les hommes politiques doivent pratiquer l'écoute attentive de leurs concitoyens, expliquer leurs décisions et leurs actes mais aussi savoir reconnaître quand ils se sont trompés. Le Grand débat national, les conventions citoyennes, les récentes interventions télévisées du chef de l'état manifestent ce souci de l'autre, essentiel à la vie démocratique.
Olivia Leboyer
[1] Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. II (1840), chap. III « Que les sentiments des peuples démocratiques sont d'accord avec leurs idées pour concentrer le pouvoir ».
[2] Jean-Philippe Vincent, « La confiance et l'envie », revue Commentaire, n°150, été 2015.
[3] Dominique Schnapper, « Emmanuel Macron : Pourquoi cette haine ? », Telos, 28 janvier 2019.
[4] C’est la position des Anti-Fédéralistes, dans le débat de Philadelphie pour la ratification (1787) qui les a opposés aux Fédéralistes. Là où les Fédéralistes insistaient sur la nécessité de préserver la distinction d’une élite nettement supérieure aux gouvernés, les Anti-Fédéralistes privilégiaient un idéal de ressemblance et même, plus exactement, de similitude entre les représentés et leurs représentants.
[5] Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, op.cit., en particulier t. II , II, 1 ; III, 1 et III, V.