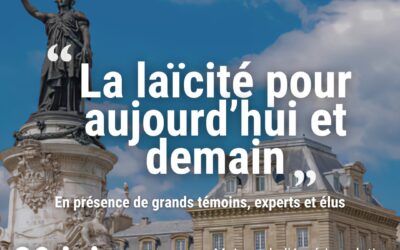Thierry Froment est ancien magistrat du parquet et juge d’instruction, ancien Co-directeur de l’Institut de Sciences Criminelles de Montpellier, membre de l’ARPC (Association de recherche en politique criminelle de Montpellier) et responsable de la sécurité ainsi que de la politique de la ville d’une grande station balnéaires du sud de la France. Aujourd’hui consultant spécialisé notamment en politique pénale, co-construction de diagnostics et de projets de contrats locaux de prévention de la délinquance et de sécurité, il évoque pour le Laboratoire de la République, la situation judiciaire des émeutes résultant de la mort de Nahel, 17 ans, à Nanterre.
Le Laboratoire de la République : A la suite du décès de Nahel le 27 juin 2023 à Nanterre et des troubles graves qui en ont résulté, le Garde des Sceaux a émis une circulaire prescrivant une « réponse pénale ferme », privilégiant notamment le défèremment. Ce souci de démonstration d’autorité est-il pertinent ou excessivement corrélé à l’actualité ?
Thierry Froment : Les émeutes qui ont suivi le décès du jeune Nahel ont été en quelque sorte un amplificateur des difficultés, parfois des malentendus que connaît notre police républicaine. D’abord parce que la police est devenue trop souvent l’instrument d'une stratégie politique de certains pour toucher un pouvoir à qui on veut l'assimiler. On se plaît à la dire alors inféodée, raciste, violente et tout passer sous cette lunette déformante pour contester l’autorité du gouvernement. Mais aussi, cette affirmation récurrente des policiers devenue adage populaire : « on les attrape et ils sont remis en liberté avant que l’on soit rentré au commissariat », traduit, plus qu’une incompréhension des décisions judiciaires, une forme d’impuissance à traiter une délinquance jeune, complexe et redondante.
La circulaire du Garde des Sceaux du 30 juin dernier a eu l’effet bénéfique de mobiliser les parquets sur l’objectif d’une réponse judiciaire immédiate en rappelant les moyens de procédure à disposition : comparution immédiate pour les majeurs, présentation immédiate pour les mineurs facilitée par la réforme récente du Code de Justice Pénale des mineurs, mise en jeu de la responsabilité civile voire pénale des parents et l’interopérabilité entre les parquets pour prêter main forte aux juridictions les plus saturées.
Donner une capacité de réponse judiciaire rapide aux délits constatés, exige des services de police des procédures de flagrance de très bonne qualité, argumentées en termes de preuve des faits constatés et de respect des droits. C’est une réelle difficulté dans un contexte de comportements violents et de délinquance de foule. Sur ce point, l’expérience, tant sur le fait générateur de ces événements que sur la gestion même des émeutes, plaide pour une généralisation de l’usage des caméras piéton conformément aux dispositions de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Enfin une réponse judiciaire rapide demande en contrepartie une capacité à diligenter en urgence des enquêtes sociales et des enquêtes de personnalité de qualité, ce qui a été rendu possible par les récentes réformes et notamment la loi du 26 février 2021 facilitant les mesures d’enquête éducative pour les mineurs.
Réagir vite, oui, mais en gardant la pleine maîtrise de l’individualité de la peine, principe majeur de notre droit pénal. La circulaire du Garde des Sceaux a donc eu l’effet mobilisateur, rassurant et qualitatif recherché, sans être dans la réaction mais en privilégiant l’efficacité, la lisibilité et la cohérence de l’action publique.
Le Laboratoire de la République : Quelle est, selon vous, la place de la réponse judiciaire face à un problème largement sociétal témoignant d’une défiance démocratique ?
Thierry Froment : La réponse judiciaire est essentielle à la vitalité de notre démocratie. D’abord parce qu’elle est indépendante du pouvoir exécutif et qu’elle est rendue en notre nom à tous, au nom du peuple français. Parce qu’elle est le verbe et l’autorité de la Loi qui protège, sanctionne et apaise. Mais aussi parce qu’elle est l’autorité qui prend le temps d’écouter, de comprendre et de décider.
Elle est aussi l’autorité capable de pardonner avec un arsenal de mesures qui vont de la dispense d’inscription au casier judiciaire, jusqu’à l’exemption de peine. Sur ce point, j’ai la conviction que notre justice doit s’adapter à l’évolution de la société et disposer de plus d’outils de « pardon judiciaire » en facilitant et raccourcissant les procédures de désinscription du casier judiciaire ou en prononçant des peines automatiquement effaçable au terme d’un délai sans récidive. Il faut parfois pouvoir casser cette fatalité de l’engrenage dans la délinquance par un casier judiciaire qui désigne et marque définitivement des jeunes au sceau de l’infamie, sans permettre réellement une nouvelle chance.
En exigeant de la Justice une plus grande sévérité, ne doit-on pas aussi permettre d’équilibrer la réponse par une faculté de pardonner et ramener ainsi plus de citoyens au cœur de notre contrat social républicain.
A côté de cela, il est urgent de créer un vrai réseau d'agents en capacité de réaliser en temps réel des enquêtes de personnalité également pour les majeurs, des agents assermentés avec l’autorité de représentants de l'État, qui soient des antennes dans des quartiers pour repérer, suivre et intervenir auprès des jeunes comme des majeurs. Des personnes de référence aussi pour faciliter les relations avec les administrations et les autorités et qui concilient les deux missions essentielles et parfois concurrentes : celle de la « prévention-intégration » incarnée par les éducateurs de rue, et celle de la « médiation-sécurité » représentée par les médiateurs sociaux. Des référents avec l’autorité suffisante pour ne pas avoir la complaisance des anciens « grands frères » ni la suspicion répressive prêtée dans les quartiers à la police de proximité.
Cette Justice moderne avance avec un budget enfin à la hauteur des enjeux de société et des mesures qui commencent à porter leur fruits en matière de délais, d’accessibilité et de simplification des procédures.
Le Laboratoire de la République : Dans ce contexte impliquant deux policiers, l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) a été saisie. Composé d’une grande majorité d’officiers ou de commissaires, cet organe devrait-il évoluer sur le même modèle que celui du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) étant constitué majoritairement de personnalités extérieures ?
Thierry Froment : CSM et IGPN ou IGGN (Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale) ne peuvent être placés sous le même plan. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est un organe constitutionnel, chargé de garantir l’indépendance de la Magistrature (Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958). C’est pour éviter toute pression sur les juges qu’il est à la fois instance disciplinaire et gestionnaire objectif de la carrière des magistrats. Il n’est pas un service d’enquêtes judiciaires. L’IGPN au contraire est un service d’enquêtes disciplinaires et judiciaires sous l’autorité du ministère de l’intérieur dans le premier cas, et de la Justice dans le second. Les enjeux et les missions ne sont donc pas les mêmes.
Certains Pays européens ouvrent davantage ce service spécialisé à des personnalités qui ne sont pas des fonctionnaires de police, mais aucune statistique ne permet de dire que cela aurait une influence quelconque sur le nombre de procédures impliquant des policiers, révélées ou conduites à leur terme.
Permettre un contrôle et un regard extérieur plus complet sur l’IGPN peut être débattu, ce n’est pas un sujet tabou, la défenseure des Droits ayant déjà un regard sur les difficultés dont elle peut être saisie par les justiciables dans ce domaine.