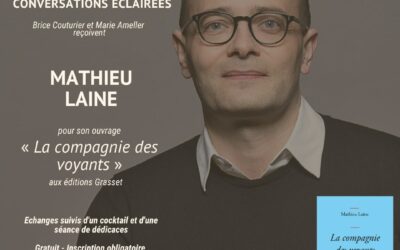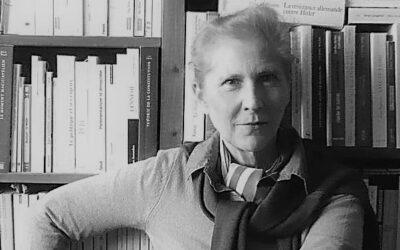Entrepreneur, essayiste et professeur à Sciences Po, Mathieu Laine sera l’invité des Conversations Éclairées le 15 mars prochain, pour présenter son nouvel essai, La compagnie des voyants (Grasset). Il évoque aujourd’hui pour le Laboratoire de la République le rôle qu’il assigne à la littérature et aux grands écrivains en démocratie.
Le Laboratoire de la République : Dans un monde où renaissent les idéologies, la littérature a-t-elle encore une place ? Si oui, laquelle ?
Mathieu Laine : La place de la littérature est d’autant plus essentielle dans nos sociétés que les idéologies non seulement renaissent mais se radicalisent. L’idéologie n’est pas néfaste en soi. Le primat d’une idée, d’un bouquet de valeurs donne son plein sens au combat politique. Il n’y a rien de pire qu’une politique déracinée prétendant à l’absolu pragmatisme technocratique et clinique, qui est une idéologie refusant de se donner un nom et un mal se prenant pour son remède. La floraison du Laboratoire de la République prend racine dans une terre républicaine, son Manifeste invitant à transformer ce creuset en action par la répétition d’un puissant « Nous devons ».
Le risque véritable des idéologies contemporaines, de ces constructivismes de la déconstruction et des néo-communautarismes actuels, c’est qu’ils prétendent exercer une domination hégémonique dans notre rapport au monde, aspirant au fond à éteindre la lumière et toute forme de débat, de confrontation sereine des idées contraires. Cette prétention à l’exclusivité intellectuelle devient d’autant plus nocive lorsqu’une idéologie se construit ou s’érige en opposition à d’autres : les positions se figent, les esprits se ferment et nous ne parvenons plus à comprendre ou à dialoguer avec le camp d’en face.
Face à ce danger viscéral pour la démocratie et ses piliers essentiels que l’on croyait, non sans naïveté, définitivement acquis sur nos terres, la littérature offre un précieux remède. Elle ouvre les portes et les fenêtres de l’esprit humain en nous plongeant dans D’autres vies que la mienne, pour reprendre le si beau titre d’Emmanuel Carrère. Elle nous vaccine contre la tentation du simplisme, des effets de bulle et de l’enfermement idéologique. Car l’ouverture à l’autre, la rencontre avec l’altérité sont inscrites dans son code génétique. C’est la nature même de la littérature de nous donner de vivre les émotions des personnages et de les transformer, par sédimentation en nous, en recul, en compréhension, en maturité humaniste. Pour citer Maurice Blanchot, « L’expérience de la littérature est l’épreuve même de la dispersion, elle est l’approche de ce qui échappe à l’unité ». Justine Augier résume également à merveille le rôle des lettres face aux revendications idéologiques : « Quoi qu’elle ait à raconter, quelle que soit sa forme, la littérature défait ce qui enferme »;la littérature « fait vivre la pluralité en chacun, donne vie en soi à d’autres regards sur le monde ».
La littérature est la vigie et la gardienne de notre esprit critique. Elle s’avère d’autant plus précieuse lorsque celui-ci est menacé par le discours à œillères des faux prophètes. Un roman à la main, « nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune » écrit Marcel Proust dans Le temps retrouvé. C’est grâce à elle que Kamel Daoud s’est arraché à l’islamiste radical qui ne supporte que la lecture d’un seul livre. C’est aussi elle qui a permis à Michel Schneider de se sortir du Maoïsme, la lecture de La Recherche lui ayant parue incompatible avec l’idéologie totalisante qu’il récitait comme on le fait d’un catéchisme.
Le Laboratoire de la République : Vous citez régulièrement la phrase de Roland Barthes : « La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. » L’émancipation ne passe-t-elle pas aussi par la littérature de combat, en prise directe avec la réalité sociale ou politique, d’Annie Ernaux à Virginie Despentes que vous évoquez d’ailleurs dans La compagnie des voyants ?
Mathieu Laine : La littérature est une arme plus puissante qu’il n’y paraît. Voilà pourquoi les dictateurs veulent toujours écrire un livre et l’imposer à tous tout en ayant horreur des romanciers et de leurs romans. Bien entendu, la littérature de combat, ou littérature engagée, est essentielle pour permettre aux sociétés humaines d’évoluer vers davantage de liberté et de fraternité. Le combat de la littérature réside précisément dans le choix d’opter pour les mots plutôt que les fusils : l’engagement n’implique pas nécessairement la violence, bien au contraire. Virginie Despentes a mille fois raison lorsqu’elle écrit Vernon Subutex et nous fait découvrir les vicissitudes d’autres vies que la nôtre tout en nous mettant en garde contre la tentation de la haine (« C’est vivifiant, la haine. Il n’y a qu’à aller sur Twitter pour comprendre que tout le monde en a envie ») et ô combien tort lorsqu’elle défend, dans un élan abjecte, les terroristes ayant perpétré les attentats de janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. A ce sujet, je suis fidèle à la vision du Contre Sainte-Beuve de Proust : peu importe l’auteur, sa vie et sa pensée, seule l’œuvre m’intéresse et c’est pourquoi cette trilogie à toute sa place dans ma Compagnie des voyants. « On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments » affirmait déjà André Gide. La puissance subversive de la littérature, cette puissance explosive dans Mario Vargas Llosa parle si bien, réside dans sa capacité à interroger la validité, la pérennité et la légitimité de nos modèles sociaux, politiques, économiques ou intellectuels. Écrire, mais aussi lire et relire (mon livre invite aussi à relire !), c’est refuser de se contenter du monde tel qu’il est. En ce sens, la littérature offre bien un chemin d’émancipation.
Le Laboratoire de la République : Il y a quelques mois, des propos tenus par Michel Houellebecq dans la revue Front Populaire ont soulevé de nombreuses critiques. Les grands écrivains sont-ils toujours de bon conseil ?
Mathieu Laine : Si la littérature cultive l’esprit critique, c’est aussi et parfois surtout pour que nous puissions en faire preuve face aux grands écrivains eux-mêmes. Le cas Céline illustre assez l’ambivalence du génie littéraire : on ne lit pas Voyage au bout de la nuit et Bagatelles pour un massacre (l’un des trois pamphlets céliniens, à vomir d’antisémitisme et de haine) de la même manière. On en revient, comme je l’évoquais à l’instant, à la distinction essentielle formulée par Marcel Proust dans son Contre Sainte-Beuve : l’homme n’est pas l’œuvre, l’œuvre n’est pas l’homme. Le critique littéraire Sainte-Beuve affirmait que l’œuvre d’un écrivain constituait le reflet de sa vie. Proust refuse l’équation et sépare la production intellectuelle ou artistique des événements biographiques : « L’homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n’est pas la même personne ». Certes, « on ne donne rien si libéralement que ses conseils » nous avertit François de La Rochefoucauld dans ses Maximes. Il faut toujours se méfier de ceux qui ont la prétention d’avoir toujours raison. Camus nous avait prévenu et je préfèrerai toujours la nuance humaniste enracinée sur des valeurs fortes à la radicalité qui encapsule et, à la fin, qui exclut ou pire encore.
Le Laboratoire de la République : L’œuvre de Roald Dahl, jugée trop « offensante », a été récemment réécrite par la maison d’édition Puffin Books, ce qui a provoqué une vive polémique. Comment résister aux dérives de la cancel culture ?
Mathieu Laine : La réécriture de l’œuvre de Roald Dahl est d’autant plus préoccupante que l’auteur n’est plus là pour donner son point de vue sur ces changements : l’histoire de la littérature est pleine de ces travaux de réagencement, de suppression ou de modification, mais ils sont traditionnellement l’apanage de l’auteur ! Ou du censeur, dans les pays désertés par la tradition républicaine et la liberté d’expression. Il est proprement scandaleux qu’une maison d’édition ait pu se prêter à un tel exercice sans l’accord de l’écrivain. L’inquiétude face à la montée de la cancel culture tient au fait que cette censure existe désormais au sein même des démocraties : la Grande-Bretagne, comme le montre l’exemple de Roald Dahl, mais aussi les États-Unis, ce dont témoignait déjà Philip Roth en 2000 (!) avec La Tache, où Coleman Silk, professeur d’université, est injustement renvoyé au prétexte qu’il aurait employé un qualificatif raciste pour désigner deux élèves absents de son cours : « « Raciste », il avait suffi de prononcer le mot avec une autorité officielle pour que ses alliés prennent leurs jambes à leur cou jusqu’au dernier »… Le roman de Roth illustre particulièrement bien les dangers du moralisme hypocrite et la dérive fascisante de la culture woke, qui refuse ce qu’est la science comme le débat démocratique, à savoir la confrontation sereine, apaisée et libre des idées contraires, et tente de réécrire non seulement les œuvres littéraires, mais aussi l’Histoire pour faire triompher une vision biaisée du monde. Pour lutter contre cette radicalisation de la bien-pensance, il conviendrait d’abord de respecter, de sanctuariser l’héritage culturel qui est le nôtre, y compris pour le critiquer. Ce travail de préservation et de mémoire est prégnant chez Toni Morrison, par exemple : elle se confronte ouvertement au passé traumatique des Afro-Américains dans son roman Beloved, dont la dédicace (« Soixante millions et davantage ») rend hommage aux victimes de la traite négrière, sans pour autant sombrer dans l’injonction à réécrire ou à exclure. Il serait également intéressant que les détracteurs de certains ouvrages proposent à leur tour une production intellectuelle ou artistique en accord avec leur vision du monde. Plutôt que de réécrire l’ancien, pourquoi ne pas commencer par écrire le nouveau ? Il est plus facile de s’armer d’un correcteur orthographique moralisateur pour piétiner le legs d’un auteur que de faire œuvre soi-même. Si l’on entend défendre la liberté autant que la responsabilité, c’est pourtant le seul chemin moralement acceptable.
Romans « républicains » de la sélection
Mathieu Laine : "La littérature est l'alliée de l'esprit critique" - Laboratoire de la République (lelaboratoiredelarepublique.fr)
Si l’on entend par « républicain » une tradition politique alliant l’héritage intellectuel des Lumières, la laïcité, la justice sociale, la délibération démocratique et la défense du progrès, voici quelques livres de La Compagnie des voyants qui me semblent correspondre à l’adjectif, même s’ils le sont tous, à mon sens.
Lady L., Romain Gary : dénonciation magnifiquement incarnée du terrorisme intellectuel et politique, de l’idéologie destructrice ; refus de céder au pouvoir magnétique d’un leader charismatique, Armand Denis, qui dicte à ses acolytes leurs opinions comme leurs comportements. Le roman de Gary nous met en garde contre la dictature de l’émotion – passion amoureuse, orgueil démesuré ou bons sentiments aveugles : ainsi, Lady L. considère les anarchistes comme « des rêveurs d’absolu qui prennent leur noblesse et l’exquise qualité de leurs sentiments humanitaires pour une doctrine sociologique ». Lord Glendale avertit Lady L. avant même qu’elle ne prenne conscience de son aliénation intellectuelle : « Vous êtes tous les deux des passionnés, vous ignorez entièrement les latitudes tempérées, les seules où le bonheur humain se manifeste parfois avec quelque chance de durer » ; ces « latitudes tempérées » ne sont-elles pas précisément celles défendues par le projet républicain ?
Sa Majesté des mouches, William Golding: Ralph le démocrate contre Jack le démagogue. La conque, symbole de la libre-parole et du débat démocratique, joue un rôle fédérateur essentiel. Tant qu’un enfant la tient dans ses mains, il a le droit de s’exprimer, d’interroger les choix du groupe et de proposer d’autres modèles à ses congénères. Sur l’île des enfants perdus, le coquillage représente littéralement la res publica, qui fait de l’organisation sociale une « chose publique ».
Les Démons, Fiodor Dostoïevski : le roman de Dostoïevski offre précisément le négatif du projet républicain. Bien que la Russie soit encore un empire en 1873, l’auteur nous met en garde contre « l’un des maux les plus dangereux de notre civilisation actuelle », à savoir l’extrémisme idéologique. A la fois pamphlet politique et drame métaphysique, Les Démons nous invitent à nous défier de tout projet réformateur qui repose sur une doctrine simpliste, une appropriation du pouvoir et la violence arbitraire.
La Ferme des animaux, George Orwell: là encore, Orwell nous présente moins la république idéale que son dévoiement funeste. L’hypocrisie des cochons, qui n’hésitent pas à affirmer que « Tous les animaux sont égaux » avant de préciser que « certains le sont plus que d’autres », réduit progressivement à néant la liberté que les animaux de la ferme pensaient conquérir en chassant les humains. Avant de faire la révolution, choisissons attentivement ceux qui vont succéder aux dirigeants en place, nous dit Orwell, qui nous rappelle également l’importance du débat démocratique. Le tyran n’est pas le seul à saborder la république des animaux ; les moutons, qui bêlent à l’unisson, ne laissent aucune place aux protestations des autres membres de la communauté : « certains animaux auraient peut-être bien protesté, si à cet instant les moutons n’avaient entonné leurs bêlements habituels » ; ils « mirent fin à la discussion », « ruinant toute chance de discussion ». Quant au cheval Malabar, il y croit, il se donne, et il finit chez l’équarisseur : sublime invitation aux croyants et aux idiots utiles de se défier des promesses de Grands soirs.
Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis : pour la croyance indéfectible en la puissance du progrès. A la croisée de la fable et du manuel d’histoire, Pourquoi j’ai mangé mon père reflète avec humour l’éternel débat qui agite nos sociétés, entre conservatisme et progrès, entre repli et ouverture. « Back to the trees! » ; « Remontons dans nos arbres et n’en bougeons plus ! » prône l’oncle Vania, effaré par l’ambition de son frère Edouard, qui ne cesse de réfléchir aux manières d’améliorer la vie quotidienne des pithécanthropes. « On peut avancer ou reculer (…) rester sur place est impossible » : aller de l’avant en privilégiant l’inventivité et l’innovation à la défiance ou à la crispation identitaire, voilà justement le projet d’Edouard, républicain avant l’heure à maints égards.