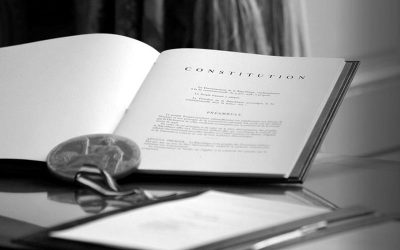Les ministres de l’Éducation français et québécois dénoncent la culture de l’annulation (cancel culture) dans une lettre ouverte.
Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, et le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la France, Jean-Michel Blanquer, s’associent contre la culture de l’annulation qu’ils jugent « à mille lieues des valeurs de respect et de tolérance sur lesquelles se fondent nos démocraties ». En effet, pour les deux ministres, « cette mouvance constitue un terreau fertile pour tous les extrêmes qui menacent la cohésion de nos sociétés. […] Sans contrepoids à l’influence pernicieuse de la culture de l’intolérance et de l’effacement, les valeurs démocratiques — liberté d’expression, égalité, laïcité — qui nous unissent risquent inévitablement de s’affaiblir. »
Ces deux ministres s’engagent ensemble, car pour eux « ce phénomène frappe autant la France que le Québec », et concerne leur sujet commun, l’école, qu’ils voient comme un « rempart primordial contre l’ignorance et l’obscurantisme ».
Ils comptent notamment organiser « une rencontre de jeunes pour débattre de ces questions aux côtés d’intellectuels » qui rassemblerait les deux pays.
Vous pouvez lire le texte en entier ici : https://www.lelaboratoiredelarepublique.fr/publications/lecole-pour-la-liberte-contre-lobscurantisme/
Et découvrez quelques réactions de la presse canadienne :
La Presse :https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-10-21/quebec-et-paris-s-allient-contre-la-culture-de-l-annulation.php
Journal de Québec :https://www.journaldequebec.com/2021/10/21/jean-francois-roberge-sallie-au-ministre-anti-woke-demmanuel-macron
Radio-Canada :https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1833421/quebec-woke-france-legault-macron-blanquer-roberge-tintin-livres?
Le Devoir :https://www.ledevoir.com/societe/641979/jean-francois-roberge-et-jean-michel-blanquer-signent-une-lettre-contre-la-culture-de-l-annulation